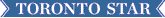Sécurité publique Canada
L'incidence de l'intimidation au Canada
Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime
- Qu'est-ce que l'intimidation?
- Quelle est l'étendue du problème de l'intimidation?
- Qui sont les intimidateurs?
- Qui sont les victimes?
- Quel rôle jouent les pairs?
- Le rôle de la famille
- Le rôle de l'école
- Le rôle du contexte social en général
- Que faire pour réduire l'intimidation?
- Conclusion
- Références
Les Canadiens s'inquiètent du degré de violence dans la société moderne et se préoccupent de la sécurité de leurs collectivités et du bien-être de leurs enfants. Comme nous le savons, trop d'enfants sont victimes de violence et d'agression dans les cours de récréation à l'école, sur les terrains de jeu et ailleurs. Selon certaines études, le comportement violent parmi les jeunes augmente et cette violence est dirigée contre d'autres jeunes et est commise par des enfants plus jeunes que par le passé. Toujours d'après les recherches effectuées, une façon efficace d'empêcher la violence chez les jeunes et de réduire l'incidence des crimes violents est d'intervenir dès que les enfants manifestent les premiers signes d'un comportement antisocial. L'intimidation est un phénomène qui contribue à l'adoption de ce genre de comportement.
L'intimidation est un grave problème pour ceux qui s'y livrent, pour leurs victimes et pour les collectivités où ce phénomène se produit. Il ne s'agit pas d'un aspect normal de la croissance. L'intimidation peut rendre les enfants craintifs et malades, leur donner le sentiment d'être isolés et les rendre malheureux. En outre, les jeunes qui intimident les autres sont plus susceptibles également d'adopter des comportements antisociaux (Farrington, 1993). Certaines études révèlent que 30 % à 40 % des enfants qui manifestent des problèmes d'agressivité ont un comportement violent lorsqu'ils sont adultes (Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau?Brunswick).
La nature de l'intimidation change avec l'âge :
- Sur les terrains de jeu, parmi les jeunes enfants,
l'intimidation consiste souvent à pousser les autres, à les couvrir
d'injures, à les taquiner ou à les isoler;
- À l'adolescence, l'intimidation peut commencer à inclure le
harcèlement sexuel, les attaques par des bandes et la violence dans
les fréquentations;
- À l'âge adulte, l'intimidation peut se présenter sous la forme d'agressions physiques, de violence conjugale, de mauvais traitements infligés à des enfants, de harcèlement au travail et de maltraitance de personnes âgées (Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau?Brunswick).
Chez les victimes, de l'intimidation répétée peut causer de la détresse psychologique et de nombreux autres problèmes (Besag, 1989; Olweus, 1993). Les effets de l'intimidation vont au-delà de l'intimidateur et de la victime et se ressentent dans tout le groupe, à l'école et dans toute la collectivité. Il est important d'arrêter ce genre de comportement à un jeune âge et de s'évertuer à créer un environnement sûr et paisible pour tout le monde.
En comprenant les facteurs qui conduisent à l'intimidation, nous pourrons créer des mesures de prévention et d'intervention qui réduiront ce phénomène et qui encourageront les enseignants, les parents et les autres enfants à intervenir quand il se produit.
|
La Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime du gouvernement du Canada a été lancée en 1998 pour aider les Canadiens à combattre les problèmes difficiles que constituent la criminalité et la victimisation. La stratégie nationale repose sur un principe logique, à savoir que la meilleure façon de réduire la criminalité est de se concentrer sur les facteurs qui peuvent conduire une personne à adopter un comportement criminel, c'est-à -dire de se concentrer sur des facteurs comme la violence familiale, les problèmes à l'école et la toxicomanie - il s'agit d'empêcher le crime avant qu'il ne soit commis. En fournissant des outils, en transmettant des connaissances et en offrant un soutien, la stratégie aide les collectivités à s'occuper de leurs problèmes uniques liés à la criminalité et à la victimisation. Dans le cadre des efforts déployés auprès des collectivités, la stratégie nationale accorde une attention particulière aux enfants, aux jeunes, aux femmes et aux Autochtones. |
Dans le contexte de la stratégie nationale, on s'attache à intervenir tôt dans la vie de nos jeunes, en cherchant à régler les problèmes de comportement antisocial qu'ils manifestent avant qu'ils ne s'aggravent. Le fait d'apprendre à nos enfants de résister à ce genre de comportement et de créer des environnements sains pour eux aura des retombées positives pendant très longtemps. La stratégie fournit un appui aux collectivités et aux écoles en collaborant avec les élèves, les parents, les éducateurs et les intervenants et d'autres personnes pour mettre sur pied et faire connaître des initiatives créées par les principaux intéressés pour combattre l'intimidation.
Qu'est-ce que l'intimidation?
L'intimidation est une affirmation de pouvoir exprimé au moyen d'agressivité. Les personnes qui intimident les autres acquièrent un pouvoir sur leurs victimes physiquement, émotivement et socialement. Ce comportement peut revêtir de nombreuses formes : l'intimidateur peut se servir de sa taille et de sa force physique, de la place qu'il occupe parmi ses pairs ou de sa connaissance des faiblesses de la victime ou obtenir l'appui d'autres enfants, comme c'est le cas lorsque tout un groupe se comporte ainsi. L'intimidation émotionnelle et sociale est peut-être la forme la plus fréquente et la plus néfaste. L'intimidation peut être physique ou verbale. Elle peut être directe (face à face) ou indirecte (commérage ou exclusion) (Olweus, 1991). À force de répéter le comportement intimidant, l'intimidateur établit sa domination sur sa victime, qui devient de plus en plus bouleversée et craintive.
Quelle est l'étendue du problème de l'intimidation?
Durant un sondage mené en 1997 auprès de Canadiens, 6 % des enfants interrogés ont admis intimider d'autres enfants " plus d'une ou de deux fois " pendant une période de six semaines et 15 % des enfants ont signalé qu'ils avaient été la victime d'intimidation à la même fréquence (Pepler, et al.). Les chercheurs qui ont observé des enfants dans la cour de récréation et en classe confirment que l'intimidation se manifeste fréquemment : toutes les sept minutes dans la cour de récréation et toutes les 25 minutes en classe (Craig and Pepler, 1997). Or, pour comprendre le problème que représente l'intimidation, nous devons examiner les caractéristiques de toutes les personnes impliquées dans l'incident : l'intimidateur, sa victime et l'observateur. Nous devons examiner également les contextes sociaux dans lesquels cette intimidation a lieu, comme la famille, le groupe des pairs, l'école et la collectivité.
Qui sont les intimidateurs?
Chez les enfants, l'intimidation peut revêtir de nombreuses formes-il n'existe pas un type de personnalité en particulier qui prédispose les enfants à ce genre de comportement. Les caractéristiques qui suivent ont été définies essentiellement dans le cadre de recherches portant sur les garçons.
- Sexe : Les garçons et les filles sont impliqués dans
des incidents d'intimidation comme auteurs, victimes ou
observateurs plus ou moins à la même fréquence, bien que
les membres de chaque sexe expriment ce comportement de
différentes façons. Plus de garçons que de filles
signalent qu'ils ont un tel comportement; les garçons
affirment davantage qu'ils se livrent à des formes
physiques d'intimidation tandis que les filles sont plus
portées à se livrer à des formes indirectes
d'intimidation, comme le commérage et l'exclusion (Craig
and Pepler, 1997).
- Âge : De 4 à 10 ans, l'agression est dirigée
principalement contre les enfants de même sexe
appartenant au groupe, tandis que de 11 Ã 18 ans,
l'agression peut se diriger contre des personnes du sexe
opposé faisant partie du même groupe également. En
outre, les élèves de 11 et 12 ans signalent qu'ils
intimident plus fréquemment les autres élèves que cela
n'est le cas dans les groupes d'élèves plus jeunes ou
plus âgés (Pepler, et al.).
- Tempérament : Les intimidateurs tendent à être
hyperactifs, Ã avoir un comportement perturbateur et Ã
être impulsifs (Lowenstein, 1978; Olweus, 1987).
- Agression : Les intimidateurs sont généralement
agressifs envers leurs pairs, enseignants, parents et
frères et sœurs (Olweus, 1991). Ils tendent à s'affirmer
et se laissent facilement provoquer. Ils sont attirés
par des situations où il y a un certain degré
d'agressivité et ont des attitudes positives vis-à -vis
de l'agressivité (Stephenson et Smith, 1989).
- Force physique : Les garçons qui intimident les
autres sont plus forts physiquement et ont besoin de
dominer les autres (Olweus, 1987).
- Manque d'empathie : Ces enfants ressentent peu de compassion pour leurs victimes et leur comportement ne leur cause pas ou très peu de remords (Olweus, 1987).
Qui sont les victimes?
Les enfants deviennent des victimes pour de nombreuses raisons différentes - il n'y a pas un seul profil pour toutes les victimes. Chez certains enfants, les caractéristiques décrites ci-après peuvent être présentes avant que l'intimidation ne survienne, alors que chez d'autres, elles peuvent en être le résultat.
- Sexe : Dans les enquêtes, les garçons risquent
autant que les filles de déclarer qu'ils ont été
victimes (Charach et al., 1995; Pepler et al., 1977).
- Âge : La victimisation décroît avec le niveau de
scolarité : 26 % des élèves de la 1re à la 3e année
indiquent qu'ils ont été victimes, contre 15 % chez les
élèves de la 4e à la 6e année et 12 % chez ceux de la 7e
et de la 8e année (Pepler et al.). Les enfants des
niveaux inférieurs courent davantage le risque d'être
victimes d'intimidateurs plus âgés qu'eux, alors que les
enfants de niveau scolaire plus élevé risquent plus
d'être victimes d'intimidateurs de leur âge.
L'intimidation directe est exercée davantage à l'endroit
des écoliers plus jeunes, et l'intimidation indirecte, Ã
l'endroit des écoliers plus âgés (Olweus, 1993).
- Tempérament : Les enfants victimisés ont tendance Ã
être angoissés et repliés sur eux-mêmes. Les indications
le confirmant sont plus nombreuses parmi les enfants
d'âge préscolaire que parmi les enfants d'âge scolaire.
- Apparence physique : Les recherches effectuées ne
permettent pas de confirmer le stéréotype populaire que
les victimes ont des traits physiques inhabituels
(Olweus, 1991).
- Estime de soi : Souvent, les victimes signalent
avoir une piètre estime de soi, probablement parce
qu'elles font l'objet d'intimidation de façon répétée
(Besag, 1989).
- Dépression : Aussi bien les garçons que les filles
qui sont victimes d'intimidation manifestent des
symptômes de dépression, comme de la tristesse et une
perte d'intérêt pour les activités (Slee, 1995; Craig,
1997).
- Angoisse : Les garçons et les filles qui sont victimes d'intimidation font état de symptômes d'angoisse, comme la tension, les craintes et l'inquiétude (Neary and Joseph, 1994; Slee, 1995).
Quel rôle jouent les pairs?
Souvent, lorsqu'il y a intimidation, il n'y a pas juste deux protagonistes-85 % des incidents d'intimidation se produisent dans le contexte d'un groupe de pairs (Atlas et Pepler, 1997; Craig et Pepler, 1997). Bien que 83 % des élèves déclarent que le fait d'être témoin de scènes d'intimidation les met mal à l'aise (Pepler et al., 1997), les observations révèlent que les pairs jouent des rôles multiples dans les scènes d'intimidation : ils se mettent de la partie, ils applaudissent, ils observent passivement le déroulement de l'incident et interviennent à l'occasion.
- Les autres enfants ont tendance à accorder une
attention positive à l'intimidateur plutôt qu'à la
victime. Leur renforcement du comportement de
l'intimidateur peut servir à maintenir le pouvoir de ce
dernier sur la victime et à l'intérieur du groupe.
L'intimidateur peut également exercer une influence sur
les pairs qui l'observent.
- Les pairs qui observent des scènes d'intimidation
peuvent devenir excités et sont plus susceptibles de se
mettre de la partie.
- Comparativement aux filles, les garçons risquent
davantage d'être attirés par des scènes d'intimidation
et de prendre part activement à l'intimidation (Craig et
Pepler, 1997; Salmivalli et al., 1996).
- Durant l'observation de cours de récréation, on a constaté que les pairs interviennent dans des scènes d'intimidation nettement plus souvent que les adultes : 11 % des scènes par opposition à 4 % (Craig and Pepler, 1997).
Le rôle de la famille
Les enfants acquièrent leurs premiers modes de comportement à la maison. Il est important que les parents créent au sein de la famille un environnement qui décourage le comportement intimidant et qu'ils offrent un appui aux enfants qui sont victimes d'intimidation.
- Les intimidateurs viennent souvent de foyers où les
parents sont négligents, hostiles et ont recours à des
punitions sévères (Olweus, 1993). Les enfants peuvent
apprendre à recourir à l'intimidation en observant les
conflits entre leurs parents. Les parents doivent
veiller à ne pas servir d'exemple pour leurs enfants en
adoptant des comportements intimidants.
- Les parents peuvent, par inadvertance, encourager
l'intimidation en acceptant que les disputes entre
frères et sœurs pour résoudre les problèmes constituent
un aspect normal de la croissance.
- Les victimes cachent souvent leurs problèmes parce
qu'elles estiment qu'elles doivent pouvoir tenir tête
toutes seules à l'intimidation. Souvent, elles
s'inquiètent de la revanche de l'intimidateur ou de la
désapprobation des autres enfants ou pensent que les
adultes ne peuvent pas faire grand?chose pour les aider
(Garfalo et al., 1987; Olweus, 1991).
- Quand elles sont assez courageuses pour en parler, les victimes s'adressent plus souvent à leurs parents qu'à leurs enseignants. À titre de principaux défenseurs de leurs enfants, les parents doivent appuyer leurs enfants victimisés en collaborant avec l'école afin d'assurer la sécurité de leurs enfants.
Le rôle de l'école
L'école joue également un rôle important dans le développement de l'enfant. Comme la famille, l'école doit établir un équilibre entre une discipline claire et cohérente et des relations chaleureuses et positives.
- Le directeur d'école. Le directeur d'école
donne le ton à son école. S'il est déterminé à combattre
le phénomène de l'intimidation, il y aura moins
d'intimidation (Charach et al., 1995). Voici
quelques-unes des stratégies utilisées par les
directeurs d'école : conséquences cohérentes et
formatrices pour les intimidateurs, politique de la
porte ouverte pour les victimes et réactions emphatiques
à leurs préoccupations, collaboration avec les
enseignants pour les aider à mieux gérer les classes et
adoption de stratégies pour les enfants perturbés.
- Les relations entre les élèves et le personnel.
L'intimidation est moins répandue dans les écoles où les
relations entre les employés sont positives, où les
relations entre ces derniers et les élèves sont
chaleureuses, où les employés et les élèves prennent les
décisions ensemble et où les adultes évitent d'adopter
des comportements intimidants qui risquent de donner un
mauvais exemple aux élèves (Olweus, 1987).
- La politique de l'école. Pour réduire
l'intimidation à l'école, la clé consiste à se doter
d'une politique claire en matière d'intimidation
assortie de suites appliquées uniformément (Olweus,
1991).
- L'organisation de l'école. L'intimidation a
tendance à se manifester davantage dans les écoles qui
insistent sur le succès scolaire sans respecter les
forces et les faiblesses des élèves (Tattum, 1982).
- La supervision des cours de récréation. Les élèves indiquent que l'intimidation survient surtout dans la cour de l'école (Olweus, 1991; Pepler et al., 1997). Ce phénomène se produit lorsque la supervision est réduite ou lorsque d'importants groupes d'enfants se livrent à des jeux non organisés ou des sports de compétition (Murphy et al., 1983).
Le rôle du contexte social en général
Les problèmes d'intimidation sont peut-être causés par le fait qu'au Canada l'agressivité est tolérée dans la culture et sur le plan social. Bon nombre de ces attitudes sont véhiculées par l'intermédiaire des médias populaires, notamment la télévision, le cinéma, la musique et les jeux vidéo. Le message uniforme transmis par ces médias est toujours le même, à savoir que l'agressivité est une bonne solution pour résoudre les problèmes sociaux. Les enfants agressifs risquent plus que ceux qui ne le sont pas d'être attirés par la violence dans les médias et de l'imiter (Huesmann et al., 1984).
Parce que le Canada est une société très diverse sur le plan culturel, les enfants peuvent être intimidés à cause de leur race ou de leur origine ethnique. En milieu scolaire, les mesures de lutte contre le racisme et le sexisme sont souvent regroupées avec les programmes de lutte contre l'intimidation, pour encourager les enfants à adopter un comportement socialement acceptable.
À l'adolescence, l'intimidation diminue quelque peu et le harcèlement sexuel augmente, entre garçons et filles aussi bien qu'à l'intérieur des groupes du même sexe. Quarante-huit pour cent des enfants de 12 ans font état de harcèlement sexuel non recherché, sous forme de commentaires, de regards, de gestes et d'injures (McMaster et al., 1997). Bien qu'un nombre égal de garçons et de filles déclarent avoir fait l'expérience de cette forme d'intimidation, un plus grand nombre de garçons que de filles reconnaissent avoir harcelé sexuellement d'autres élèves.
Que faire pour réduire l'intimidation?
Pour être efficaces, les interventions contre l'intimidation doivent aller au-delà de l'enfant agressif et de la victime pour inclure les pairs, le personnel de l'école, les parents et la collectivité en général. Bien qu'il y ait des différences appréciables entre les écoles, on peut réduire l'intimidation grâce à une perspective globale de lutte contre l'intimidation (Olweus, 1991; Pepler et al., 1996). L'élément essentiel de l'intervention est un code de conduite clairement défini, que l'on applique jusqu'au bout avec cohérence et de façon très positive. Il faut énormément de temps pour modifier les attitudes et le comportement des employés et des élèves d'une école et des parents de ces derniers. Les sections suivantes donnent un bref aperçu des éléments d'un programme de lutte contre l'intimidation.
- Le personnel de l'école. La motivation et
l'appui du personnel de l'école sont essentiels. Tous
les employés de l'école devraient participer à des
séances d'information. Ils devraient, avec les
représentants des parents et des élèves, être
responsables de la mise à jour du code de conduite et
des conséquences qu'une violation de celui-ci. Les
attitudes des enseignants se reflètent dans leur
comportement. Quand des adultes reconnaissent le
problème de l'intimidation et le rôle capital qu'ils
jouent dans sa réduction, ils supervisent activement et
interviennent pour arrêter toute situation où il y a
intimidation.
- Les parents. Les réunions de parents et les
bulletins devraient servir à informer les parents au
sujet des problèmes liés à l'intimidation. Les parents
devraient parler à leurs enfants de l'intimidation et
être sensibles aux signes de victimisation possible. La
communication entre les parents et l'école est
essentielle, étant donné que les parents sont souvent
les premiers à savoir que leurs enfants ont été
victimisés.
- Les pairs. Les pairs jouent un rôle essentiel
dans l'intimidation. Les interventions doivent viser Ã
changer les attitudes, les comportements et les normes
relatives à l'intimidation pour l'ensemble des enfants
qui fréquentent l'école où ces interventions se font.
Sous la direction des enseignants, les élèves peuvent
reconnaître le problème de l'intimidation et comment ils
peuvent aider à l'éliminer. Avec l'appui des
enseignants, ils peuvent élaborer des stratégies pour
intervenir eux-mêmes ou obtenir l'aide des adultes pour
mettre fin à l'intimidation. Le fait de promouvoir, dans
le groupe de pairs, des attitudes qui favorisent
l'empathie à l'égard de la victime et condamnent
l'agressivité réduira l'intimidation.
- Les intimidateurs et les victimes. Les intimidateurs et les victimes requièrent une attention individuelle. Dans les conversations avec les intimidateurs, on met l'accent sur l'inadmissibilité de l'intimidation et sur les conséquences de tout comportement de ce genre prévues dans le code de conduite. Si un groupe d'enfants se livre à de l'intimidation, on explique à l'intimidateur et à ceux qui l'observent quel est leur rôle et quelles sont leurs responsabilités. Dans les entretiens avec les victimes, on encourage ces dernières à s'exprimer et on confirme l'intention de l'école de les protéger contre de nouvelles manifestations de harcèlement. Dans les conversations avec les parents, on informe ces derniers des difficultés de leurs enfants et on s'assure de leur coopération pour punir les comportements d'intimidation et pour repérer les nouveaux cas d'intimidation ou de victimisation.
Conclusion
Le compte rendu que nous venons de dresser ne constitue pas une description exhaustive de tous les facteurs liés à l'intimidation et à la victimisation, mais il tente de présenter les facteurs dont il est le plus souvent question dans les ouvrages spécialisés sur le sujet. Les enfants impliqués dans l'intimidation, soit comme auteurs, soit comme victimes, peuvent avoir des attitudes négatives, une sociabilité déficiente et des difficultés émotives qui ont leur origine à la maison. Ces problèmes sont transférés en milieu scolaire et dans le groupe de pairs, où ils peuvent s'accentuer. L'apparition de problèmes de comportement antisocial dépend de l'interaction de caractéristiques individuelles et de l'exposition à des facteurs de risque à des périodes critiques du développement.
La Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime appuie des initiatives communautaires qui visent à offrir de meilleures possibilités aux enfants. Lorsque les enfants grandissent dans un environnement où ils sont en sécurité physiquement et émotivement et où on s'occupe bien d'eux durant toute leur croissance, ils ont de meilleures chances de réussir dans la vie et risquent moins d'être des victimes ou des délinquants. Des programmes qui enseignent aux enfants comment résister aux influences négatives et à avoir de l'empathie pour les autres et qui leur enseignent des compétences sociales peuvent les aider à se protéger contre les expériences néfastes.
Les interventions destinées à combattre l'intimidation devraient viser toutes les personnes impliquées : les intimidateurs, les victimes, les pairs, les employés dans les écoles, les parents et la collectivité en général. Nous avons tous un rôle à jouer en déclarant que l'intimidation ne doit pas constituer un rite de passage pour les enfants canadiens.
Références
Atlas, R., et Pepler, D. (1997). "Observations of bullying in the classroom". LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution, Université York, soumis pour publication.
Bentley, K.M., et Li, A. (1995). "Bully and victim problems in elementary schools and students' beliefs about aggression". Canadian Journal of School Psychology, 11, p. 153-165.
Besag, V.E. (1989). Bullies and Victims in schools. A guide to understanding and management. Angleterre, Open University Press.
Boulton, M.J., et Underwood, K. (1992). "Bully l victim problems among middle school children". British Journal of Educational Psychology, 62, p. 73-87.
Charach, A., Pepler, D., et Ziegler, S. (1995). "Bullying at School: A Canadian perspective". Education Canada, 35, p. 12-18.
Craig, W. (1997). "The relationship among aggression types, depression, and anxiety in bullies, victims, and bully / victims". Personality and Individual Differences, sous presse.
Craig, W., et Pepler, D. (1997). Naturalistic observations of bullying and victimization on the playground. LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution, Université York. Rapport inédit.
Craig, W.M., et Pepler, D.J. (1995). "Aggression and victimization: Are they related? Communication présentée au congrès biennal de la Society for Research on Child Development, Indianapolis, mars 1995.
Cunningham, C.E. (1997). "The effects of primary division, student-mediated conflict resolution programs on playground aggression ". Département de psychologie, Chedoke-McMaster Hospitals, Hamilton (Ontario) L8N 3Z5.
Farrington, D.P. (1993). "Understanding and preventing bullying". Dans M. Tonry (sous la direction de), Crime and Justice, 17, Chicago, University of Chicago Press.
Fine, E.S., Lacey, A., et Baer, J. (1995). Children as Peacemakers. Portsmouth (N.H.), Heinemann.
Garfalo, J., Siegel, L., et Laub, M. (1987). "School related victimization among adolescents: An analysis of National Crime Survey narratives ". Journal of Quantitative Criminology, 3, p. 321-337.
Huesmann, L.R., Lagerspetz, K., et Eron, L.D. (1984). "Intervening variables in the TV violence-aggression relation: Evidence from two countries ". Developmental Psychology, 20, p. 746-775.
Lowenstein, L. (1978). Who is the bully? Bulletin of the British Psychological Society, 31, p. 147-149.
Maines, B., et Robinson, G. (1992). The No Blame Approach. Bristol, Lame Duck Publishing.
McMaster, L., Connolly, J., Craig, W., et Pepler, D. (1997). " Sexual harassment and dating violence among early adolescents". Communication présentée au congrès biennal de la Society for Research in Child Development, Washington (D.C.), mars 1997.
Murphy, H.A., Hutchinson, J.M., et Bailey, J.S. (1983). " Behavioral school psychology goes outdoors: The effect of organized games on playground aggression ". Journal of Applied Behavioral Analyses, 16, p. 29-35.
Neary, A., et Joseph, S. (1994). "Peer victimization and its relationship to self-concept and depression among schoolgirls". Personality and Individual Differences, 16, p. 183-186.
Olweus, D. (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Oxford, Blackwell.
Olweus, D. (1991). "Bully/victim problems among school children: Some basic facts and effects of a school-based intervention program". Dans D. Pepler et K. Rubin (sous la direction de), The Development and Treatment of Childhood Aggression, Hillsdale, p. 411-448.
Olweus, D. (1987). "School-yard bullying -Grounds for intervention". School Safety, 6, p. 4-11.
O'Moore, A.M. (1989). "Bullying in Britain and Ireland: An Overview". Dans E. Roland et E. Munthe (sous la direction de). Bullying: An International Perspective. Londres, David Fulton, p. 3-21.
Patterson, G.R. (1986). " The contribution of siblings to training for fighting: A microsocial analysis". Dans D. Olweus, J. Block et M. RadkeYarrow (sous la direction de). Development of antisocial and prosocial behavior: Research, Theories, and Issues. New York, Academic Press.
Pepler, D.J., Craig, W.M., Ziegler, S., et Charach, A. (1993). " A school-based antibullying intervention: Preliminary evaluation ". Dans D. Tattum (sous la direction de). Understanding and managing bullying Oxford, Heinemann Books, p. 76-91.
Pepler, D.J., Craig, W., Ziegler, S. et Charach, A. (1994). "An Evaluation of an Anti-Bullying Intervention in Toronto Schools". Canadian Journal of Community Mental Health, 13, p. 95-110.
Pepler, D.J., Craig, W., Atlas, R., O'Connell, P, Smith, C., et Sedligdeilami, F. (1996). "AntiBullying Interventions in Schools: A Systemic Evaluation ". Symposium présenté à la Conférence sur le développement de l'enfant, Université de Waterloo, mai 1996.
Pepler, D.J., Craig, W., O'Connell, P., Connolly, J., Atlas, R., Sedigdeilami, F., Smith, C., et Kent, D. (1997). " Prevalence of bullying and victimization among Canadian elementary and middle school children ". Manuscrit en préparation.
Pepler, D.J., et Craig, W. (1997). " Bullying: Research and Interventions". Youth Update. Publication de l'Institute for the Study of Antisocial Youth.
Pikas, A. (1989). "The common concern method for the treatment of mobbing". Dans E.
Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Bjorkqvist, K., Osterman, K., Kaukiainen, A. (1996). "Bullying as a group process: Participant roles and their relation to social status within the group ". Aggressive Behavior, 22, p. 1-15.
Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick, 2001, Let's Stop Bullying! A Guide for Parents and Other Adults.
Slee, P. (1995). " Peer victimization and its relationship to depression among Australian primary school students". Personality and Individual Differences, 18, p. 57-62.
Smith, P.K., et Sharpe, S. (1994). Tackling Bullying in Your School: A Practical Handbook for Teachers. Londres, Routledge.
Stephenson, P., et Smith, D. (1989). "Bullying in two English comprehensive schools ". Dans E. Roland et E. Munthe (sous la direction de). Bullying: An International Perspective. Londres, Fulton.
Straus, M.A., Gelles, R.J., et Steinmetz, S.K. (1981). Behind closed doors. Violence in the American family. Garden City (N.Y), Anchor Books.
Tattum, D. (1982). Disruptive Behaviour in Schools. Londres, John Wiley.